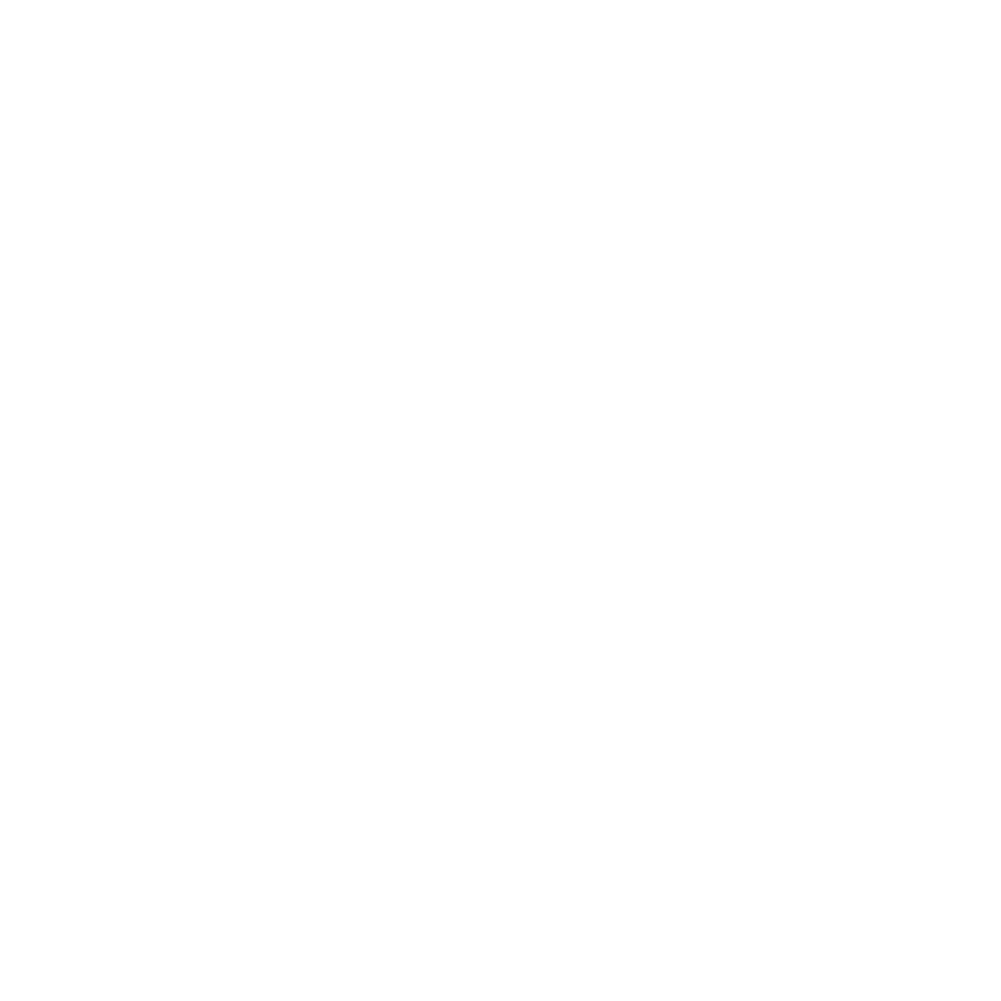La hausse massive des cyberattaques fait de la cybersécurité une responsabilité centrale pour les dirigeants. Les cadres juridiques européens (RGPD, DORA, NIS II) renforcent fortement leurs obligations : mise en place de mesures de protection, supervision des risques, contrôle des prestataires, et implication personnelle des organes de direction. Les sanctions peuvent être très lourdes : amendes élevées, responsabilité individuelle, suspension, voire poursuites pénales. En France, les dirigeants peuvent aussi être tenus civilement et contractuellement responsables en cas de manquement.

Les organes de direction (conseil d’administration, assemblée générale des actionnaires et comité exécutif) jouent un rôle crucial en définissant la vision stratégique, en garantissant une gouvernance efficace et en veillant à la bonne gestion de l’entreprise.
Face à l’essor préoccupant des cyberattaques, ces responsabilités s’étendent désormais au domaine vital de la cybersécurité, devenu un défi incontournable pour toute organisation moderne.
1. Les entreprises face à la menace invisible : l’inquiétante montée en puissance des cyberattaques bouleverse les priorités stratégiques des entreprises
Les cyberattaques se multiplient, touchant toutes les entreprises : en 2023, 278 770 atteintes numériques ont été recensées, dont 59% causant des préjudices financiers majeurs.
Les rançongiciels représentent une menace sérieuse, tandis que les risques internes proviennent aussi des employés via diverses négligences.
Face à cette menace invisible, le Parlement a adopté des textes novateurs qui placent les dirigeants au cœur même de la bataille cybernétique de l’entreprise.
2. Le Règlement Général sur la Protection des Données : l’aîné du corpus normatif qui a propulsé la cybersécurité au cœur des préoccupations des dirigeants d’entreprises
a. Ses obligations
Le RGPD a imposé aux responsables de traitement de garantir la protection des données personnelles, incluant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires (pseudonymisation, chiffrement, processus de gestion des incidents).
Ces obligations les conduisent à restructurer fondamentalement leurs dispositifs de cybersécurité. Les entités se doivent d’instaurer des mesures tant techniques qu’organisationnelles assurant l’intégrité des données personnelles. Les organes de direction sont particulièrement concernés et directement impliqués par ces exigences réglementaires.
Le RGPD leur attribue une responsabilité proactive, nécessitant la mise en œuvre de mesures adaptées aux risques évalués et périodiquement révisées face à l’évolution constante des vulnérabilités.
b. Ses sanctions
En cas de violation, la responsabilité des personnes en charge peut être engagée si les mesures préventives étaient insuffisantes ou la réponse inadaptée. Le RGPD impose des amendes administratives jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.
3. Le Règlement DORA : le cadet du corpus normatif qui a propulsé la cybersécurité au cœur des préoccupations du secteur financier
a. Ses obligations
Le règlement DORA vise exclusivement le domaine financier, imposant des structures de résilience opérationnelle exigeantes comprenant des évaluations périodiques, des vérifications minutieuses et une communication claire avec les autorités de régulation. Les organes de direction sont tenus d’assurer la conformité à ces obligations, sous risque de sanctions individuelles. Les dirigeants sont personnellement impliqués dans la gestion de la stratégie numérique de leur entreprise.
Une vigilance particulière est accordée par DORA aux prestataires externes, notamment les fournisseurs de services cloud, dont les établissements financiers doivent certifier le respect des critères de cybersécurité. Dès lors, il incombe aux organes de direction de s’assurer que leurs tiers respectent les normes de cybersécurité. Ainsi, ils peuvent être considérés comme responsables des incidents émanant de ces tiers.
b. Ses sanctions
DORA établit un cadre de responsabilité individuelle applicable aux dirigeants des entités critiques. Ces derniers peuvent être tenus responsables s’ils n’ont pas déployé les mesures adéquates pour anticiper ou atténuer les conséquences des cyberattaques. Le règlement prévoit des sanctions administratives pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros ainsi que des poursuites personnelles à l’encontre des dirigeants ayant fait preuve de négligence.
4. La Directive NIS II : la benjamine du corpus normatif qui a étendu le champ d’application de la Directive NIS I
a. Ses obligations
Tandis que la directive NIS I s’appliquait à seulement quelques centaines d’organisations stratégiques, la directive NIS II étend son champ d’application à approximativement 10 000 entités, réparties sur 18 secteurs d’activité (contre 7 auparavant), en établissant une distinction claire entre les entités essentielles et importantes.
NIS II engage spécifiquement la responsabilité des dirigeants dans la gestion des incidents cyber. Les personnes physiques des organes de direction sont pleinement impliquées dans la gestion du risque cyber.
Les organes de direction des entités « essentielles ou importantes » sont tenus d’entériner officiellement les dispositifs de cybersécurité, d’en contrôler le déploiement, et pourraient être jugés responsables en cas de manquement. Ces dirigeants s’exposent à une suspension temporaire de leurs fonctions jusqu’à la régularisation complète des exigences de conformité.
La directive NIS II exige également l’évaluation et la maîtrise des risques inhérents à la chaîne d’approvisionnement, contraignant ainsi les organisations à analyser rigoureusement les mesures de cybersécurité adoptées par leurs fournisseurs et à incorporer des dispositions contractuelles précises.
b. Ses sanctions
Au même titre que DORA, NIS II fixe un régime de responsabilité personnelle pour les membres des organes de direction des entités critiques. Leur responsabilité peut être engagée s’ils n’ont pas pris les mesures raisonnables pour prévenir ou limiter les impacts des cyberattaques. NIS II prévoit également des amendes administratives pouvant atteindre plusieurs millions d’euros et des sanctions personnelles pour les dirigeants négligents.
5. Quid à l’échelle nationale ? Les dirigeants risquent de payer le prix fort
a. Responsabilité pénale
Le Code pénal français établit un cadre juridique précis concernant la responsabilité des dirigeants en cas de cyberattaques découlant de négligences significatives ou de manquements aux obligations sécuritaires.
L’article 226-17 prévoit notamment des sanctions pour la conservation inadéquate de données personnelles sensibles. Un manque de vigilance peut conduire à des sanctions pénales conséquentes, incluant des peines privatives de liberté, des amendes considérables ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions dirigeantes.
b. Responsabilité civile
Conformément à l’article 1240 du Code civil, la responsabilité d’une entreprise peut être engagée lorsqu’une faute ou une négligence de sa part occasionne un préjudice. Par exemple, une intrusion informatique malveillante découlant d’une insuffisance dans la gestion des infrastructures numériques est susceptible d’imputer à l’organisation la responsabilité des préjudices subis par des tiers, notamment les répercussions économiques et atteintes à l’image.
Les dédommagements dus aux personnes lésées peuvent engendrer des conséquences pécuniaires considérables tant pour la structure que pour ses administrateurs.
c. Responsabilité contractuelle
Enfin, la responsabilité contractuelle peut être engagée lorsqu’une cyberattaque impacte un fournisseur, partenaire ou client dans le cadre d’une relation contractuelle établie. Le manquement aux obligations relatives à la sécurisation des données peut contraindre à indemniser les préjudices subis par le cocontractant. Dans l’hypothèse d’une mise en jeu de la responsabilité contractuelle, les répercussions potentielles incluent des indemnisations financières, la résiliation de contrats commerciaux et des contentieux juridiques prolongés.
Avocat associé
Avocate collaboratrice