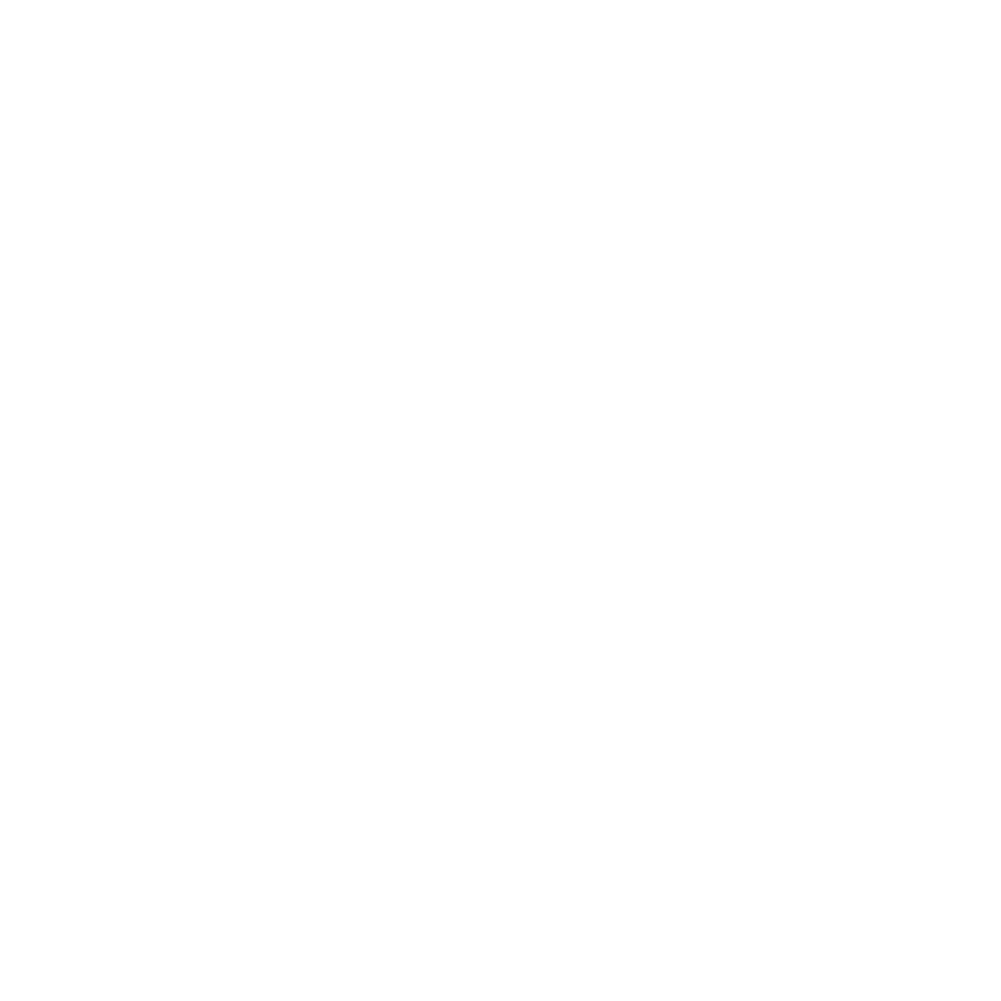Une étude de 2022 révèle que 17,9 % des salariés dans le monde ont subi un harcèlement psychologique au travail. Le harcèlement moral peut être descendant, horizontal ou ascendant et se caractérise par des agissements répétés entraînant (ou risquant) une dégradation des conditions de travail, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention de nuire. Depuis 2009, la Cour de cassation reconnaît le harcèlement managérial lorsque les méthodes de gestion ciblent un salarié, mais refuse la notion de harcèlement institutionnel sans preuve individuelle. Récemment, la justice envisage de qualifier en homicide involontaire un harcèlement ayant conduit au suicide, ce qui pourrait alourdir les sanctions contre les dirigeants.

Selon une étude conjointe en date du 2 décembre 2022, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de la Lloyd’s Register Foundation et de Gallup, 17,9% des salariés hommes et femmes dans le monde indiquent avoir fait l’objet de violence et de harcèlement psychologiques dans leur vie professionnelle, soit 583 millions de personnes1.
Véritable phénomène sociétal, le harcèlement moral au travail est logiquement devenu un phénomène judiciaire, générant une abondante jurisprudence qui a dessiné, au fil du temps et de la conjoncture sociale, les contours évolutifs d’une incrimination légale particulièrement sujette à interprétation.
Dernier développement en date : la notion de harcèlement managérial, ou institutionnel, qui a le vent en poupe puisqu’elle surfe sur un double phénomène plus large de promotion d’une part de la qualité des conditions de travail et d’autre part de la dénonciation des conditions indignes.
Mais cette notion de management managérial n’a pas été consacrée sans limites.
Explications.
D’abord, rappelons que si le harcèlement moral doit s’inscrire dans une relation de travail entre l’auteur et la victime, il peut être bien sûr descendant (d’un employeur vers un subordonné), mais aussi « horizontal » (entre salariés), voire ascendant (d’un salarié envers son employeur), l’existence d’un lien hiérarchique ou d’autorité n’étant pas exigée.
Ensuite, l’infraction de harcèlement moral est constituée de trois éléments : des agissements interdits, un résultat (ou l’éventualité d’un résultat) et une intention coupable.
- Les agissements répréhensibles : « Des propos ou comportements répétés »
Peu précise, cette notion a fait l’objet d’une jurisprudence fournie de la Cour de cassation pour permettre de tracer les contours des comportements ou propos incriminés.
Pour synthétiser, peuvent être considérés comme comportements ou propos répétés suivants susceptibles d’entraîner une dégradation des conditions de travail de la victime (liste non exhaustive) :
- la mise à l’écart d’un salarié, comme la suspension des moyens de communication tels que la ligne téléphonique et la messagerie électronique du salarié, même en arrêt de travail, ou dès lors que le salarié subit « des changements quotidiens de tâches et de secteur et une mise à l’écart des autres employés auxquels elle ne devait pas adresser la parole » ;
- La pression permanente, les injures, brimades, humiliations, dénigrements, réflexions désobligeantes et menaces de mise à pied ; « un mode paternaliste de gestion » peut également constituer un harcèlement s’il porte atteinte à la dignité humaine ou bien une surveillance excessive (interdiction d’aller aux toilettes, de parler avec d’autres salariés, etc.) ;
- les ingérences dans la vie personnelle, commele fait « d’interdire à une salariée d’être malade » et de « lui conseiller de ne plus faire d’enfants », ou « d’imposer des conditions de travail insupportables à une salariée » en l’observant à tous instants et en la critiquant sur le plan professionnel ou sur sa vie privée ;
- Affectation à des tâches sous-qualifiées ou surqualifiées.
Le résultat - Les propos ou comportements doivent avoir « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
- La simple possibilité de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans atteinte effective, suffit à caractériser le délit de harcèlement moral.
L’intention coupable - La Cour de cassation n’est pas exigeante pour la preuve de l’élément intentionnel dès lors que « le délit de harcèlement moral n’implique pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail ».
- Il n’est donc pas exigé d’intention de nuire, ni même que l’auteur ait voulu le dommage subi par la victime. Cependant, le harceleur doit avoir eu l’intention de répéter des comportements ou propos précis à l’égard d’un salarié : ainsi, on ne saurait lui reprocher uniquement une attitude générale de management, aussi toxique qu’il soit.
- Un mode de management autoritaire suffit-il à caractériser l’infraction ?
Par un arrêt du 10 novembre 2009 confirmé par la suite, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré la notion de harcèlement moral managérial, le définissant comme les « méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cependant, la Cour de cassation rejette la notion de harcèlement institutionnel : une politique d’entreprise, fût-elle sévère, ne suffit pas à constituer en soi le délit de harcèlement à l’égard de chacun des salariés, quand bien même cette politique générerait de la souffrance au travail.
Si la mise en place d’une telle politique peut démontrer l’intention délictueuse du dirigeant conscient de la souffrance entraîné par son management, encore faut-il caractériser, à l’égard de chaque salarié, qu’il est victime de propos et comportement répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses propres conditions de travail.
Les juges doivent donc examiner scrupuleusement si les éléments constitutifs du harcèlement sont réunis au cas par cas, et il n’est pas rare qu’à défaut, un dirigeant soit relaxé.
*
Signalons enfin que la Cour de cassation a récemment semblé favorable à ce que le harcèlement d’un dirigeant ayant entraîné le suicide du salarié soit sanctionné au titre de l’homicide involontaire, dès lors que le harceleur a « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage », sous réserve que soit caractérisée contre lui une faute délibérée ou caractérisée.
Cet arrêt va dans le sens de l’accroissement de la répression des dirigeants trop sévères, par une assimilation des faits de harcèlement à ceux d’homicide involontaire, ouvrant la voie à un possible cumul d’infractions et à une aggravation des sanctions.
Avocat associé
Monsieur Colin DUPAS
Elève-avocat
[1]
Organisation internationale du travail, Lloyd’s Register Foundation, Gallup, Données d’expériences sur la violence et le harcèlement au travail : première enquête mondiale (page 8)
[2]
Selon l’article 222-33-2 du code pénal : « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » L’article L1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dans des termes sensiblement identiques.
[4]
Avis du Conseil économique et social des 10-11 avr. 2001, Amendement de la commission des affaires sociales du Sénat (JO Sénat CR, 25 avr. 2001, p. 11432) opinion du garde des Sceaux (JO Sénat CR, 3 mai 2001, p. 1625 et 1658).
[5]
Cass. soc., 24 octobre 2012, n°11-19.862
[6]
Cass. soc., 6 avril 2011, n°09-71.170
[7]
Cass. crim., 23 avril 2003, n°02-82.971
[8]
CA Montpellier, ch . corr. 3, 16 oct. 2008
[9]
CA Grenoble, 3 mai 1999, ch. soc., SA Adecco c/ Savelli
[10]
CA Nancy, 13 nov. 2000, ch. soc., n°99/02834, Christophe c/ SA Vilroc
[11]
CA Grenoble, 30 avr. 2001, ch. soc., n°98/01028 ; CA Nancy, 30 janv. 2002, ch. soc. n°01/02517
[12]
Cass. crim., 6 déc. 2011, no10-82.266 ; 14 janv. 2014, no11-81.362
[13]
Cass. crim., 24 mai 2011, n°10-87.100
[14]
Cass. crim., 13 nov. 2019, no18-85.367
[15]
Cass. crim., 13 décembre 2016, n°15-81.853
[16]
Cass. soc., 10 nov. 2009, n°07-45.321 ; voir aussi 15 juin 2017, n°16-11.503
[17]
Cass. crim., 19 oct. 2021, n°20-87.164 ; 12 avr. 2023, n°22-83.661 ; 25 juin 2024, n°23-83.613
[18]
Cass. crim., 19 nov. 2024, n°24-80.942
[19]
Selon l’article 221-6 du code pénal, l’homicide involontaire est puni de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45 à 75 000 euros d’amende.
# Droit pénal du travail # Droit pénal des affaires # Avocat pénaliste