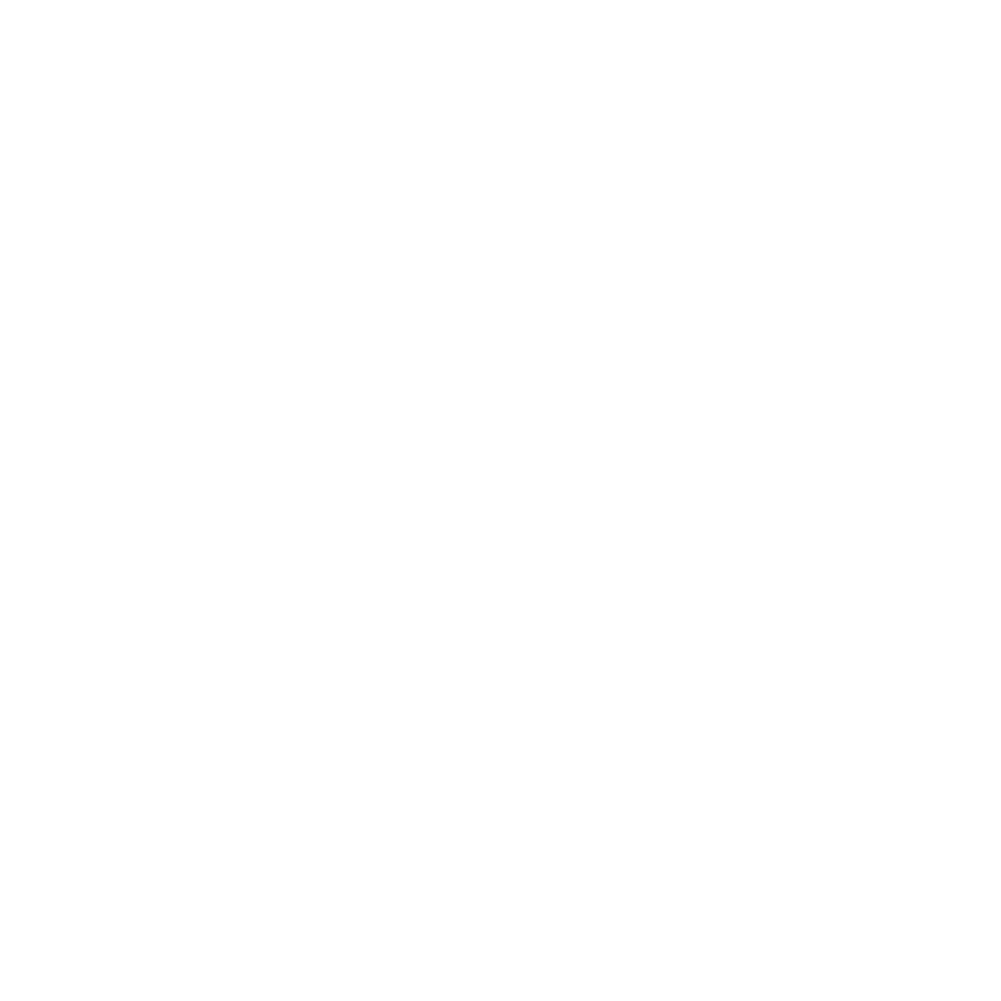En droit du travail, tout travail mérite salaire, même en cas de dispense de préavis par l’employeur après un licenciement. Dans ce cas, il doit verser une indemnité compensatrice, équivalente au salaire que le salarié aurait perçu. Exceptions : Dispense demandée par le salarié Inaptitude non professionnelle Absence prolongée perturbant l’entreprise Refus de modification des conditions de travail Adhésion au CSP (indemnité versée à France Travail) Le principe de solidarité impose malgré tout le paiement dans certains cas (accident du travail, maladie pro, licenciement économique).

« Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire » (Evangile de Luc, chapitre 10, verset 7).
Le droit du travail s’est construit sur un principe constant, et intangible, celui voulant que tout travail exécuté par le salarié donne obligatoirement lieu au versement d’une rémunération.
C’est d’ailleurs ce principe qui permet de différencier l’activité salariée, du bénévolat, lequel implique l’exécution d’une prestation de travail, pour servir une cause, dans une logique parfaitement altruiste, restant éloignée de toute considération pécuniaire.
En dehors de ce cadre strict du bénévolat, le législateur a entendu sanctionner lourdement l’employeur du fait de l’absence de paiement du salaire, en prévoyant, à son encontre, des sanctions pénales et civiles se voulant dissuasives.
Si la question du paiement du salaire ne pose aucune difficulté lorsqu’une prestation de travail est effectivement réalisée par le salarié, certaines situations particulières contraignent néanmoins l’employeur à devoir rémunérer celui-ci, alors même qu’il se trouve en situation d’inactivité.
Tel est notamment le cas des congés payés, ou des absences pour maladie liées à un accident du travail, ou une maladie professionnelle.
Ces deux situations restent, néanmoins, intimement liées à l’exécution d’une prestation de travail.
En effet, il sera rappelé que l’indemnité de congés payés constitue, en réalité, un droit acquis du fait d’une prestation de travail effectuée antérieurement.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, l’employeur est censé participer à un système d’assurance sociale, lui permettant de couvrir les risques physiques ou psychologiques auxquels sont exposés les salariés du fait du travail réalisé pour son compte.
Dans la présente étude, nous allons, plus particulièrement, nous intéresser à une autre situation, celle de la dispense de préavis découlant d’un licenciement, lorsque celle-ci est à l’initiative de l’employeur.
Cette situation est relativement habituelle et s’explique par une considération d’ordre psychologique, l’employeur considérant que son salarié ne peut s’investir correctement dans ses missions, alors même qu’il a été poussé vers la sortie.
Dans cette configuration, l’employeur peut-il alors refuser de payer ce salarié, en arguant d’une justification objective voulant que celui-ci ait physiquement quitté l’entreprise, et qu’il ne fournisse plus aucune prestation de travail ?
N’en déplaise à l’employeur, le principe veut qu’en matière de licenciement, la dispense de préavis qui n’est pas à l’initiative du salarié entraîne le versement d’une indemnité compensatrice correspondante (I.).
Par exception, la loi et la jurisprudence prévoient que, dans certaines hypothèses très particulières, le salarié puisse effectivement se voir priver de cette indemnité, du fait de sa situation (II.).
I. Le paiement obligatoire du salarié licencié durant son préavis non exécuté
Il sera rappelé que, par principe, tout licenciement, hors faute grave, faute lourde, ou inaptitude, est censé donner lieu à l’exécution d’un préavis par le salarié.
Sur le fondement de l’adage, le préavis est dû par celui qui rompt, l’employeur devient alors le débiteur de cette obligation d’offrir au salarié le droit d’exécuter ce préavis.
Néanmoins, pour des raisons tout à fait compréhensibles, un certain nombre d’employeurs préfèrent dispenser leur salarié d’exécuter ce préavis, de peur de subir la démotivation de celui-ci, ou plus simplement, une mauvaise ambiance de travail.
Dans cette hypothèse, le Code du travail vient imposer à l’employeur qui dispenserait son salarié de l’exécution de son préavis, à l’issue de son licenciement, de verser à celui-ci une indemnité compensatrice d’un montant égal aux salaires qu’il aurait effectivement perçu durant cette période de préavis (Article L.1234-5 du Code du travail).
La jurisprudence considère, en outre, que l’indemnité versée en compensation ne doit pas avoir pour effet d’appauvrir le salarié du fait de la non-exécution de son préavis.
C’est pourquoi celui-ci pourra percevoir, à l’euro près, la rémunération qui lui aurait été effectivement versée s’il avait exécuté son préavis, que ce soit sa rémunération fixe, comme sa rémunération variable (Cass, Soc. 17 mai 2017, n°15-20.094).
Le maintien de salaire concerne également les avantages en nature, notamment ceux relatifs aux véhicules de fonction, lesquels doivent être laissés à la disposition du salarié durant la période qui aurait été celle de son préavis (Cass, Soc. 11 juillet 2012, n°11-15.649).
Cette obligation est d’ailleurs parfaitement indépendante de la situation financière dans laquelle se situe le salarié durant ce préavis non exécuté.
Le salarié ne peut ainsi se voir priver de cette indemnité compensatrice, même lorsqu’il est démontré qu’il a retrouvé un autre emploi (Cass, Soc. 27 novembre 1991, n°88-43.917).
Cette indemnité doit également être verséelorsque le salarié se trouve en arrêt-maladie avec une prise en charge par la sécurité sociale (Cass, Soc. 31 octobre 2012, n°11-12.810).
Le maintien de la rémunération s’inscrit alors dans une logique strictement indemnitaire, ayant pour objet de compenser les effets de l’éviction du salarié avant l’issue du préavis.
Si ce maintien de la rémunération est compréhensible lorsque c’est l’employeur qui est à l’origine de la dispense de préavis, il en est autrement lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité matérielle et objective d’exécuter celui-ci.
Tel est notamment le cas des licenciements intervenant à la suite de la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle, autrement dit les inaptitudes liées à la survenance d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle.
Dans ces circonstances, quand bien même le salarié ne peut, compte tenu de son état de santé, et de l’inaptitude reconnue par le médecin du travail, exécuter son préavis, l’employeur est quand même tenu de lui verser une indemnité équivalente à celle qui aurait été perçue si celui-ci avait pu effectivement l’exécuter (Article L.1226-14 du Code du travail).
Ce régime favorable peut d’ailleurs surprendre, lorsque l’on sait que le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle (donc indépendante d’une maladie professionnelle, ou d’un accident du travail) se voit, quant à lui, privé de toute indemnité compensatrice de préavis.
Pour comprendre cette différence notoire affectant le coût du licenciement, il convient de revenir à la genèse du régime de la gestion des risques professionnels, laquelle veut que l’employeur fasse preuve d’une certaine solidarité lorsque l’inaptitude du salarié a été générée directement par le fait de son travail.
Enfin, il sera intéressant de souligner qu’en matière de licenciement pour motif économique, l’inactivité du salarié ne peut constituer un obstacle à l’obligation de l’employeur de lui payer un préavis.
Tel est ainsi le cas lorsque la Société a cessé son activité, de manière stratégique, ou forcée, par un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de Commerce.
Dans le même esprit, il est imposé à l’employeur de débourser un montant équivalent à l’indemnité de préavis, lorsque le salarié licencié économiquement adhère au CSP (contrat de sécurisation professionnelle).
Dans cette hypothèse, le salarié va quitter ainsi immédiatement les effectifs de l’entreprise, en arrêtant de fournir une prestation de travail, pour être pris en charge immédiatement par FRANCE TRAVAIL (ex-Pôle Emploi).
Le paiement du préavis interviendra alors d’une manière particulière, puisque, in fine, le montant de celui-ci ne sera nullement versé au salarié directement, mais à FRANCE TRAVAIL, dans le cadre d’un mécanisme de solidarité visant à ce que l’employeur participe au financement du dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Cette obligation peut s’avérer particulièrement défavorable à l’employeur, lequel va être contraint de payer un préavis non exécuté dans un contexte économique dégradé, au risque d’être confronté à une possible cessation des paiements.
Ce maintien de l’obligation de paiement du préavis en matière de licenciement économique démontre d’ailleurs que, paradoxalement, celui-ci constitue l’un des modes de rupture le plus coûteux pour l’employeur.
Fort heureusement, le droit du travail ne fait nullement du paiement du préavis non exécuté un principe absolu.
Il existe ainsi de nombreuses situations dans lesquelles l’employeur peut s’abstenir d’un tel paiement, notamment eu égard à l’attitude adoptée par son salarié.
II. Les dérogations au principe du paiement du préavis non exécuté
Certaines situations liées à l’attitude, ou à la condition du salarié licencié, permettent à l’employeur de s’exonérer du paiement de son préavis.
Tel est tout d’abord le cas lorsque c’est le salarié, lui-même, qui sollicite une dispense d’exécution de son propre préavis.
Cette hypothèse intervient, en réalité, assez régulièrement, notamment lorsque l’égo du salarié est fortement atteint par le licenciement prononcé, mais également lorsque celui-ci a tout simplement trouvé un nouvel emploi durant l’exécution de son préavis.
Dans cette situation, l’employeur devra, néanmoins, veiller à obtenir un écrit de la part du salarié sollicitant cette dispense, sous peine de voir considérer que celle-ci est, en réalité, intervenue à son initiative.
En matière de dispense du paiement du préavis, il n’est donc pas souhaitable qu’un doute subsiste sur l’auteur de la demande.
Une autre situation permet également à l’employeur de s’abstenir du paiement du préavis non exécuté, celle dans laquelle l’état de santé du salarié est si dégradé, qu’il empêche objectivement celui-ci d’exécuter la moindre prestation de travail durant cette période.
Tel est le cas des licenciements pour inaptitude non professionnelle, vus en infra, mais également des licenciements intervenant pour absence prolongée troublant gravement le fonctionnement de l’entreprise.
Dans cette dernière hypothèse, le salarié est licencié du fait, non pas de sa maladie, en elle-même, mais de son absence, dès lors que celle-ci cause d’importants dommages à son employeur.
Ce type de licenciement, qui concerne, d’une manière générale, de hauts cadres de l’entreprise, atteints le plus souvent de longues maladies, permet à l’employeur ne pas verser d’indemnité compensatrice de préavis (sauf comme toujours en droit du travail, existence d’une clause conventionnelle contraire – tel est par exemple le cas de la CCN des Hôtels, cafés, Restaurants).
Ce non-paiement du préavis, fondé sur l’impossibilité pour le salarié d’exécuter celui-ci, pose néanmoins question lorsque l’on sait qu’en matière de licenciement disciplinaire, ou pour insuffisance professionnelle, le préavis doit obligatoirement être payé, même lorsque le salarié se place en arrêt-maladie pour faire échec à son obligation de l’exécuter.
Enfin, la jurisprudence est venue confirmer qu’une nouvelle exception de taille en matière de non-paiement du préavis inexécuté venait désormais à s’appliquer.
Ainsi, lorsqu’un salarié refuse une modification de ses conditions de travail, et plus généralement d’un élément non-contractuel, il encourt le prononcé d’un licenciement pour faute simple (la jurisprudence considérant que ce refus ne pouvait, en soit, constituer une faute grave).
Dès lors, l’employeur était, jusqu’alors, tenu au paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
Or, dans la plupart des situations, le refus du changement des conditions de travail implique l’impossibilité pour le salarié d’exécuter, matériellement, son préavis.
Tel est notamment le cas lorsque ce refus équivaut à ne pas accepter le déménagement de l’entreprise dans le même secteur géographique, ou un changement d’affectation sur un poste relevant de la même qualification.
Dans ces deux hypothèses, le refus du salarié se manifeste souvent par une absence de volonté de reprendre son poste dans les nouvelles conditions.
Jusqu’à récemment, l’employeur qui prenait la décision de licencier son salarié pour un refus de modification de ses conditions de travail était tenu de payer celui-ci alors même que, de son initiative, le préavis n’était pas exécuté.
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient récemment de mettre fin à cette difficulté en précisant que, dans cette situation, le salarié ne pouvait décemment prétendre au paiement de son préavis, dès lors que son refus des nouvelles conditions revenait à refuser d’exécuter celui-ci (Cass, Soc. 23 octobre 2024, n°22-22.917).
Par cet arrêt, la Cour de cassation aligne donc le régime du licenciement pour refus de changement des conditions de travail sur celui pour inaptitude non professionnelle, ou pour absence prolongée.
Néanmoins, et contrairement à ces deux derniers licenciements, le salarié peut parfaitement, à l’issue de la notification de la rupture, décider de changer d’avis, et d’exécuter son préavis dans les conditions pourtant refusées par ses soins.
Comme tout travail mérite salaire, l’employeur ne pourra, dès lors, plus s’opposer au paiement du préavis dans la mesure où celui-ci a bien été exécuté.
Avocat associé
#droit social