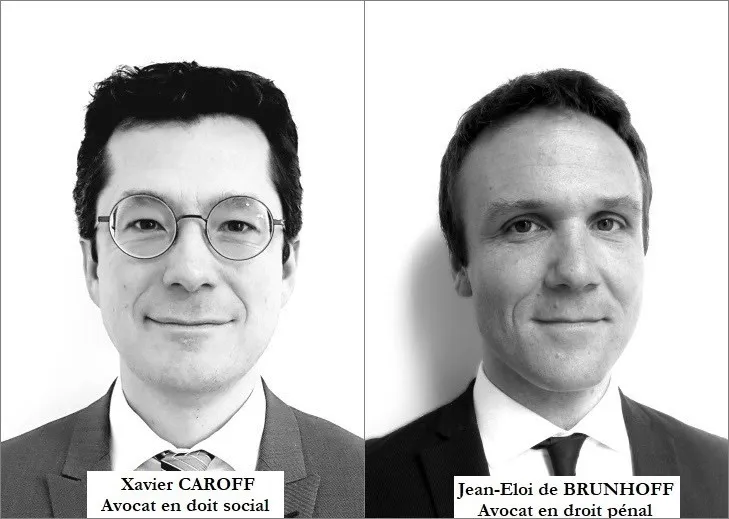« Responsable mais pas coupable ». C’est ainsi qu’avaient été repris les propos de Madame la Ministre Georgina Dufoix, alors ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale du gouvernement Fabius, à propos des affaires du sang contaminé.

L’histoire se répète aujourd’hui à propos de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Si la culpabilité pénale des différents acteurs de cette crise n’est pas reconnue, il n’en reste pas moins que leur responsabilité, notamment administrative, pourra être retenue sur plusieurs fondements.
1) La responsabilité de l’état « personne morale » pour faute dans la gestion de la crise
La responsabilité administrative de l’Etat a été reconnue, à plusieurs reprises, dans des situations de crise sanitaire en raison, soit d’agissements fautifs, soit de carences avérées de l’Etat, permettant ainsi aux victimes d’être indemnisées.
En principe, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire.
Dans l’affaire du Médiator, une faute de l’Etat a été reconnue en raison de son abstention à prendre les mesures adaptées consistant en la suspension ou au retrait de l’autorisation de mise sur le marché du Mediator à compter de la mi-1999, date à laquelle les éléments d’information sur le risque étaient connus(1).
De la même manière, dans les affaires liées à l’amiante, la responsabilité de l’Etat a été engagée en raison de sa carence fautive à prendre les mesures de prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, avant l’année 1977, alors que les risques étaient connus bien avant cette date(2).
Dans les affaires du sang contaminé, la responsabilité de l’Etat a également été engagée en raison d’une carence fautive dans l’organisation générale du service public de la transfusion sanguine, du contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l’édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, en ce que l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires, pourtant existantes, alors que le risque était connu depuis 1984(3).
Dans l’hypothèse du Covid-19, le Code de la santé publique(4) précise que qu’en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Ces dispositions octroyant un pouvoir de police spécial au Premier Ministre et au Ministre chargé de la santé, pourraient servir de fondement à l’engagement de la responsabilité de l’Etat dans la gestion de la crise actuelle.
Compte tenu de la jurisprudence précédemment citée, les questions à se poser seraient les suivantes :
- Le risque était-il connu ?
La probabilité d’une épidémie virale n’était pas inconnue et la connaissance d’un risque virologique grave et imminent ne faisait plus de doute à compter du mois de janvier 2020 après l’information par les autorités chinoises de l’existence d’un coronavirus et des incidences de ce dernier sur la santé humaine.
En outre, Madame Agnès BUZYN, alors Ministre de la santé, a indiqué avoir alerté le directeur général de la santé en décembre et le Premier Ministre le 11 janvier.
Enfin, depuis le moins de janvier, la presse parlait déjà de risque de pandémie mondiale, déclarée par l’OMS, le 11 mars 2020.
- Existait-il un moyen d’éviter ce risque ?
A ce jour, aucun vaccin ou traitement médical n’existe pour empêcher ou lutter contre la propagation du virus et de ses effets. Cette circonstance a obligé les pouvoirs publics à prendre des mesures de prévention, seul arsenal viable à sa disposition compte tenu de l’état des connaissances scientifiques actuelles, pour éviter la propagation du virus.
- Les mesures prises par l’Etat étaient-elles suffisantes compte tenu des connaissances scientifiques ?
A l’impossible nul n’est tenu. Le Juge administratif, à l’instar de toutes les affaires précédemment citées, prendra en compte l’état des connaissances scientifiques disponibles début 2020 afin de statuer sur la pertinence et la rapidité des dispositifs de lutte mis en place. Se pose ici la question de la réactivité du gouvernement à annoncer les mesures de confinement, les débats sur la gestion du stock de masques, de l’insuffisance des places en réanimation qui pourraient illustrer l’impréparation de la France et le défaut d’anticipation du risque sanitaire.
En tout état de cause, chaque victime souhaitant engager la responsabilité de l’Etat afin d’être indemnisée de ses préjudices devra apporter la preuve de la commission d’une faute, soit par la commission d’actes positifs notamment la prise de mesures inadaptées, soit par une carence fautive de l’Etat.
Or, il se peut que la Justice considère que l’Etat a eu la réaction la plus adaptée possible compte tenu la situation d’urgence dans laquelle il a fallu agir et des données dont disposaient alors les décideurs publics.
Pour l’exemple, dans un cas d’épidémie de fièvre aphteuse touchant des animaux, la jurisprudence a considéré que l’Etat n’avait commis aucune négligence : les mesures sollicitées par le requérant étant considérées comme totalement disproportionnées à la situation(5).
A l’inverse, concernant un virus attaquant les arbres, la responsabilité de l’Etat a été reconnue en raison de l’adoption tardive de mesures et d’un manque de vigilance compte tenu des données dont il disposait à l’époque(6).
Dans son discours du 13 avril 2020, le Président de la République a lui-même reconnu : « Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gels hydro alcooliques. Nous n’avons pas pu distribuer autant de masques que nous l’aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s’occupant de nos aînés, pour les infirmières et les aides à domicile« .
Bien que de nombreux responsables politiques analysent une défaillance des pouvoirs publics dans la réaction à la crise sanitaire, cela ne préjuge en rien de ce que décidera le Juge administratif, qui, malgré un niveau d’exigence élevé, pourra estimer, qu’au égard des connaissances scientifiques détenues et de l’éventail des mesures à la disposition de l’Etat, ce dernier n’aurait commis aucune faute dans la gestion de cette crise inédite(7).
2) La responsabilité des hôpitaux pour faute dans l’organisation du service
Outre la responsabilité de l’Etat personne morale, celle des établissements hospitaliers pourrait être envisagée.
En effet, à l’heure où plusieurs clusters sont dénombrés au sein d’établissements hospitaliers, notamment à Saumur ou Cholet, l’engagement de la responsabilité des hôpitaux pour défaut d’organisation du service de soins est envisageable.
Les établissements de soins ont-ils commis des manquements dans la gestion de cette épidémie ? Les mesures mises en place pour éviter la propagation du virus au sein des services et entre les patients ont-elles été suffisantes ?
Juridiquement, la responsabilité pour faute du service public hospitalier peut trouver son origine dans un problème d’organisation et de fonctionnement du service, c’est le cas notamment de l’insuffisance dans la surveillance des patients ou des locaux(8), du mauvais entretien des locaux et du matériel, de la réalisation tardive d’un examen(9), de l’insuffisance de personnel ou de relation défectueuse entre le médecin et le personnel paramédical(10).
Concernant la crise sanitaire actuelle, un médecin parisien, ancien interne à l’hôpital de Mulhouse a déclaré : « La semaine où l’on a tout raté est celle de début mars. C’est là, lorsque les cas ont commencé à affluer, qu’il fallait déclencher l’alerte absolue. On a oublié l’équation de base : à savoir qu’avec cette épidémie, le nombre de malades double chaque jour. Le corps médical a sa part de responsabilité« .(11).
Au sein des établissements hospitaliers, pourraient être constitutifs de faute l’absence de séparation suffisante entre les patients non atteints et ceux atteints par le Covid-19, l’absence de mise en quarantaine, l’insuffisance des moyens de protection individuels, la pénurie de respirateurs ou de personnels ainsi que la saturation des services de réanimation.
Preuve de la gravité de la situation, le 17 mars 2020, un document remis à la direction générale de la santé visait à aider les médecins à opérer des choix dans l’éventualité d’une saturation des lits de réanimation pour les patients Covid-19.
Autrement dit, la pénurie et le manque de moyen a conduit à faire des choix entre les patients qui, selon leurs chances de survie, valaient la peine d’être réanimés ou non.
Par conséquent, les patients qui pensent avoir contracté le Covid-19 au cours d’un séjour à l’hôpital, ou dont la prise en charge au titre d’une infection au Covid-19 a été défectueuse, auront la possibilité d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier pour faute.
Toutefois, classiquement en matière d’engagement de responsabilité, il sera indispensable de prouver, soit que le virus a été contracté au cours d’un passage à l’hôpital et que l’établissement a commis des manquements dans la prévention de la propagation du virus, soit, que la prise en charge au titre d’une infection au Covid-19 a été défectueuse en raison, notamment, du manque de moyens.
3) La responsabilité de l’employeur public en cas de contamination d’un de ses agents en service
Autre hypothèse de l’engagement de la responsabilité de l’administration dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 est celle de la contamination d’un agent dans l’exercice de ses fonctions.
Les personnels les plus à risque sont évidemment les personnels soignants, mais le reste des fonctionnaires n’est pas en reste.
D’une part, il est nécessaire d’envisager le régime avantageux qu’offrirait la reconnaissance de la contamination par le Covid-19 en maladie professionnelle.
En effet, le régime de la maladie professionnelle permet la prise en charge totale des frais médicaux, l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité si l’agent est en mesure de conserver son activité ou à une rente viagère d’invalidité s’il est considéré comme inapte à occuper toute fonction.
Pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il existe trois hypothèses :
- si la maladie est désignée par le tableau, la nouvelle présomption joue en faveur de l’agent(12) ;
- si la maladie est désignée dans le tableau mais qu’elle ne remplit pas l’ensemble des critères prévus par celui-ci, l’agent doit prouver que sa pathologie est directement causée par l’exercice de ses fonctions, de sorte que l’on se ne se trouve plus en présence d’une présomption, mais d’un commencement de preuve en faveur de l’agent(13) ;
- si la maladie n’est pas désignée par le tableau, l’agent doit apporter la preuve que sa pathologie est essentiellement et directement liée au service et qu’elle entraîne une incapacité permanente dont le taux sera fixé par un décret en Conseil d’État(14).
Le 21 avril 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran, a déclaré à l’Assemblée nationale : « S’agissant des soignants, nous avons décidé une reconnaissance automatique comme maladie professionnelle, avec indemnisation en cas d’incapacité temporaire ou permanente« .
Par conséquent, il semblerait que seuls les personnels soignants bénéficieraient de la présomption d’imputabilité au service en cas de contamination par la Covid-19. Pour les autres, il sera nécessaire d’apporter la preuve difficile que le virus a été contracté à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
D’autre part, si le fonctionnaire estime que le régime de la maladie professionnelle ne suffit pas à indemniser l’ensemble de ses préjudices, il est possible d’envisager l’engagement de la responsabilité de l’employeur.
De façon générale, l’employeur public a une obligation de sécurité et de protection de la santé des agents placés sous son autorité(15) laquelle l’oblige, d’une part, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents(16) et, d’autre part, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet(17).
Durant la période d’état d’urgence sanitaire les employeurs ont une obligation de sécurité « renforcée » envers les agents devant exercer leurs fonctions en présentiel dans la mesure ils doivent mettre en place les mesures de sécurité dites « barrières » recommandées par le Gouvernement(18).
Chaque employeur doit donc s’assurer que :
- les règles de distanciation sont respectées en adaptant l’organisation du lieu de travail ;
- le matériel nécessaire au respect des gestes « barrières » est à disposition des agents soit la possibilité de se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main et proscrire les embrassades.
En effet, le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité pour un agent, ou ses ayants-droits en cas de décès, de rechercher la responsabilité pour faute de l’employeur en raison de la carence dans son obligation de sécurité.
Conformément aux jurisprudences précitées, si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place les mesures de sécurité prévues pour prévenir toute contamination par la Covid19, alors sa responsabilité pourrait potentiellement être engagée.
Dans la perspective du risque contentieux, il serait utile que chaque employeur garde la trace écrite de l’ensemble des mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents notamment les commandes de masques, de gel hydroalcooliques ou de savon(19).
Ce régime de responsabilité permet d’indemniser des préjudices non couverts par le régime de la maladie professionnelle comme le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ou le déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, il convient d’évoquer l’hypothèse de l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
Le Conseil d’Etat a déjà reconnu, dans le cas d’une épidémie de rubéole, que le fait pour une institutrice en état de grossesse d’être exposée en permanence aux dangers de la contagion comportait pour l’enfant à naître un risque spécial et anormal qui, lorsqu’il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à engager au profit de celle-ci la responsabilité de l’administration qui l’emploie(20).
Dans le cadre de l’épidémie Covid-19 il n’est pas exclu que le juge administratif fasse application de la théorie de la responsabilité sans faute pour risque : la survenance de conséquences graves pour un agent qui ne présentait pas, a priori, de risque particulier pourrait donner lieu à application de cette responsabilité sans faute, obligeant alors la commune à le dédommager.
Par conséquent, l’ensemble des employeurs publics se doivent d’appliquer et de faire appliquer l’ensemble des prescriptions gouvernementales au sujet de la gestion de l’épidémie de Covid-19 afin qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée.
4) La responsabilité des mairies dans la gestion de la crise
a) Concernant les arrêtés pris par les maires au titre de leurs pouvoirs de police administrative
Au titre de ses pouvoirs de police administrative, le maire est le garant de la salubrité publique et de la santé publique(21).
Il est de jurisprudence constante, que les maires ont la possibilité d’aggraver, dans leurs communes, des mesures de police prises par l’Etat(22).
A ce titre, il est possible de penser que les maires ont une part de responsabilité dans la gestion de cette crise et de ses conséquences. C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé le Conseil d’Etat, selon sa jurisprudence classique(23), en jugeant que « les représentants de l’Etat dans les départements comme les maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient« . (24)
Toutefois, plusieurs décisions du Juge administratif ont censuré les décisions de maires qui ont pris des initiatives au titre de la gestion de l’épidémie. C’est le cas notamment du maire de Sceaux qui a souhaité imposer le port d’un masque dans l’ensemble de la ville(25) ou du maire de Lisieux qui a souhaité établir un couvre-feu à l’ensemble de sa population(26).
Le Conseil d’Etat a rappelé que la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 a confié à l’Etat la responsabilité d’édicter des mesures de lutte contre le coronavirus, et ce, afin d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire.
La possibilité pour les maires d’intervenir tient donc à la preuve de l’existence de circonstances locales qu’il sera nécessaire d’établir de façon consciencieuse, à défaut de quoi le Juge administratif n’hésitera pas à censurer.
Concernant les décisions précitées, les maires avaient échoué à démontrer l’existence de circonstances locales suffisantes et d’un trouble spécifique à la commune.
Par exemple, s’agissant des mesures de couvre-feu, le juge administratif a estimé que le « défaut de respect des règles du confinement dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ne saurait être regardé comme une circonstance particulière de nature à justifier une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante« . (27)
De la même manière, il faut garder à l’esprit que quelque soit la mesure de police en cause, cette dernière doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi: à chaque fois qu’une mesure de police moins contraignante peut atteindre le même objectif cette dernière doit être privilégiée(28).
Les autorités décentralisées devront donc être vigilantes dans la prise d’arrêté de nature à restreindre les libertés pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
b) Concernant les risques au titre de la réouverture des écoles
Le 28 avril 2020, le gouvernement a décidé de la réouverture des écoles et a permis aux communes d’ouvrir, selon leur volonté, les services périscolaires, notamment la restauration.
Le cas échéant, les maires se sont retrouvés avec la périlleuse mission d’organiser le retour des enfants et à mettre en place l’ensemble des mesures de sécurité afin de prévenir la circulation du virus, notamment en aménageant les locaux pour faire respecter les règles de distanciation, en mettant à disposition du savon liquide ou en nettoyant les locaux, plusieurs fois par jour.
Toutefois, si un enfant contracte le virus, la responsabilité du maire pourra être envisagée par les parents en raison de l’obligation de l’administration d’assurer la sécurité des enfants pendant le service(29).
Le juge administratif reconnaît la possibilité d’engager la responsabilité administrative d’une commune pour faute, en cas de méconnaissance de son obligation de sécurité(30).
En effet, durant les temps de récréation, de déjeuner et autres activités périscolaires, les agents devront s’assurer que les mesures de sécurité suivantes sont respectées :
- le respect du nombre limite de 15 enfants par salle ;
- le lavage des mains au minimum à l’arrivée dans la salle, avant et à la fin de chaque repas et chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques ;
- le respect de la règle de distanciation sociale d’un mètre ;
- le respect de toutes les autres mesures barrières, tel que l’usage de mouchoirs à usage unique.
Dans le cas d’une contamination par le virus à l’école, la détermination du moment où l’enfant l’a contracté est capital.
En effet, si le virus a été contracté dans le temps scolaire c’est la responsabilité de l’Etat qui devra être recherchée(31), en revanche, la commune redevient responsable dans le temps périscolaire(32) (temps de restauration scolaire, garderie, étude surveillée, activité créée à leur initiative)
Se pose alors ici, la question délicate de la preuve.
En effet, il ne sera déjà pas aisé de prouver qu’un enfant a contracté le virus dans l’enceinte de l’école, mais la difficulté des moyens de preuve se posera avec d’autant plus de force lorsqu’il conviendra d’établir à quel moment précis de la journée la contamination a eu lieu.
Dans le cas d’une infection de tuberculose, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré que la contamination d’un élève de maternelle par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, pourtant agent municipal, mais pendant le temps scolaire, engageait la responsabilité de l’Etat(33).
Concernant les collèges et les lycées, la responsabilité respective du département et de la région pourra également être recherchée. En parallèle, les chefs d’établissements, qui sont les représentants de l’Etat au sein des structures, pourront voir leur responsabilité engagée dans l’hypothèse où ces derniers n’auraient pas respecté les prescriptions et directives envoyées par les départements et les régions.
Par conséquent, il est particulièrement important de garder la preuve de la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité préconisées par le Gouvernement afin de pouvoir, en cas de contentieux, prouver qu’elles n’ont commis aucune faute.
Bernard RINEAU, Avocat Associé
Quentin PARÉE, Avocat
Elorri DALLEMANE, Avocat
Notes :
(1) CE, 9 novembre 2016, req. n°393902 ; req. n°393108; req. n°393904
(2) CE, 3 mars 2004, req. n°241150
(3) CE, 9 avril 1993, req. n°138653
(4) Article L. 3131-1 du code de la santé publique
(5) CAA Lyon, 26 novembre 2009, req. n°07LY01121
(6) CAA Marseille, 10 janvier 2005, req. n°00MA01810
(7) CE, 7 août 2008, req. n°278624
(8) CE, 27 février 1985, Centre hospitalier de Tarbes, req. n°39069-48793
(9) CE, 16 novembre 1998, Mlle Y., req. n°178585
(10) CE, 27 juin 2005, M. et Mme X., req. n°250483
(11) https://reseau-healthtech.fr
(12) article 10 IV, al. 1er de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
(13) article 10 IV al. 2 de l’ordonnance précitée
(14) article 10 IV al. 3 de l’ordonnance précitée
(15) articles 2 et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 , décret n°82-453 du 28 mai 1982
(16) CAA Paris, 6 octobre 2016, req. n°15PA02227 ; CE, 30 décembre 2011, req. n°330959
(17) CE, 30 décembre 2011, req. n°330959, CAA Marseille, 18 avril 2014, req. n°12MA00134
(18) article 2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
(19) CE, ord., 8 avril 2020, req. n°439821 ; CE, ord., 28 mars 2020, req. n°439693
(20) CE, 6 novembre 1968, Saulze, req. n°72636 ; CE, 29 novembre 1974, Époux Gevre, req.n°89756
(21) article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales
(22) CE, 18 avril 1902, req. n°04749
(23) CE, sect. 18 décembre 1959, « Les films Lutétia », req. n°36385-36428
(24) CE, 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, req. n°439674
(25) CE, ord., 17 avril 2020, req. n° 440057
(26) TA de Caen, 31 mars 2020, req. n°2000711
(27) TA Montreuil, 3 avril 2020, req. n°2003861
(28) CE, 19 mai 1933, Benjamin, req. n°17413 17520
(29) Article D.321-12 du code de l’éducation
(30) CE, 19 juillet 2017, req. n° 393288
(31) l’article L.211-1 du code de l’éducation
(32) l’article L. 212-15 du code de l’éducation
(33) CAA de Lyon, 12 décembre 2006, req. n°04LY01216