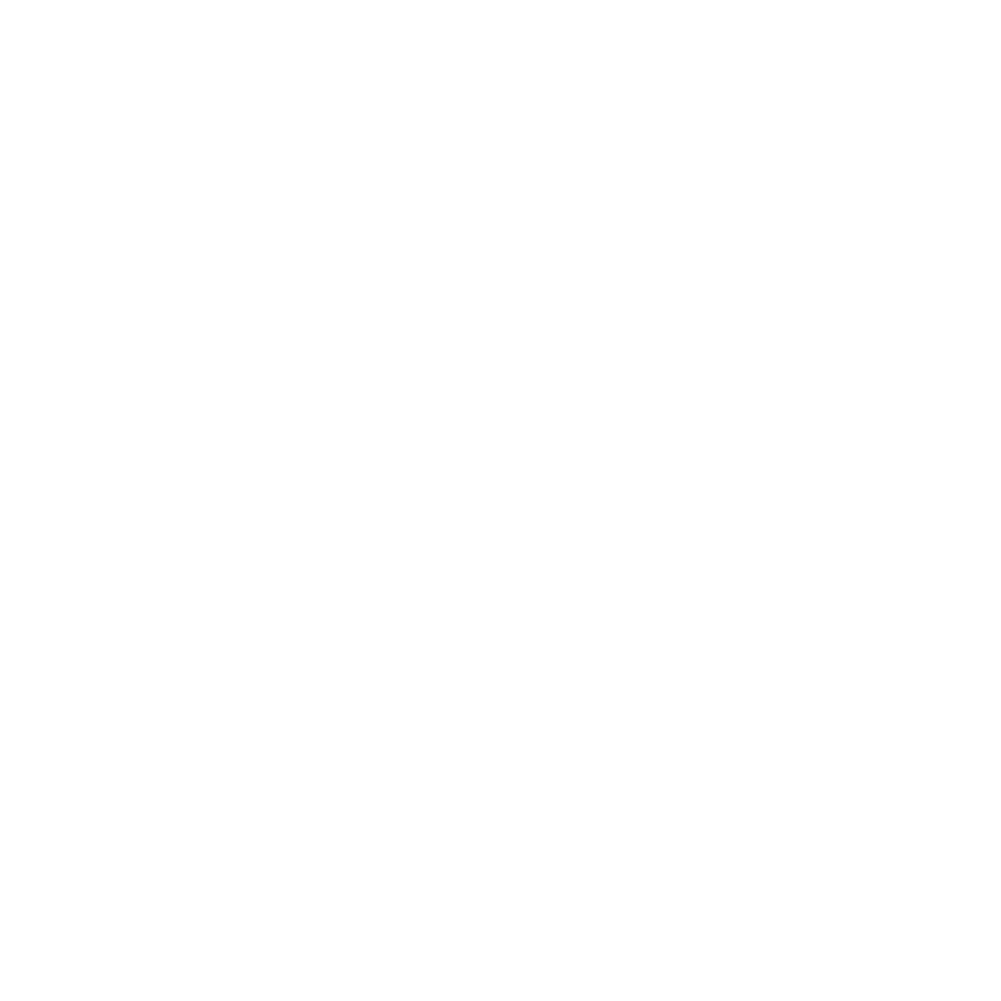Engager une action en diffamation est complexe à cause du formalisme strict de la loi de 1881, protégeant la liberté d’expression. La moindre erreur peut entraîner la nullité des poursuites. Les juges appliquent ces règles avec rigueur, bien que certaines décisions montrent une souplesse rare. Cela illustre la priorité donnée à la liberté d’expression sur la protection de la réputation.

Engager une action en diffamation ou en injure devant un tribunal correctionnel est une entreprise difficile, qu’il vaut mieux laisser à un praticien habitué, tant la procédure est semée de chausse-trappes !
Mais est-ce un mal ? Il faut le rappeler, l’un des principes cardinaux d’un Etat de droit est celui de la liberté d’expression. Il est aux fondements mêmes de la démocratie. Il n’est donc pas anormal de situer ce principe au nombre des plus essentiels à protéger, en priorité par rapport à d’autres : il protège la collectivité. Il permet de faire société.
Ce principe comporte bien sûr des limites posées par la loi, qui érige en infractions pénales certaines manifestations de la pensée (injures, diffamation, incitation à la haine, etc.), quel qu’en soit le support (paroles, écrits, vidéos, images, mails, réseaux sociaux, etc.).
Les mots comme les poings peuvent être utilisés pour blesser : il est, là aussi, normal de les sanctionner.
Cependant, tout en ménageant la possibilité pour une personne diffamée ou injuriée de laver son honneur en justice, le législateur ne lui facilite pas la tâche, loin de là, témoignant malgré tout d’une forme de préférence pour la liberté d’expression quand ce principe est en compétition avec la protection de l’honneur ou de la réputation d’un particulier.
C’est ainsi que la loi du 29 juillet 1881 sur la presse – toujours en vigueur, bien que remaniée à plusieurs reprises – met à la charge du plaideur qui engage un procès un formalisme particulièrement complexe. Les juges appliquent rigoureusement ces dispositions, et sanctionnent très souvent le non-respect de ce formalisme par la nullité de l’action.
Par exemple, en vertu des articles 50 et 53 de cette loi, l’acte qui saisit le tribunal – que ce soit une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe – doit être exempt de toute erreur de plume dans la reproduction de tel propos qualifié d’injure ou de diffamation.
Le plaignant doit « spécifier exactement les passages et propos pouvant caractériser l’infraction dénoncée »1, sans aucune équivoque possible quant à l’objet du débat2.
Si un doute ou des interrogations, quelles qu’elles soient, même marginales, peuvent naître pour la personne poursuivie, la nullité est en principe encourue.
Ainsi, une simple erreur de retranscription des propos poursuivis, même mineure, peut être une cause de nullité de toute la poursuite3, tout comme une contradiction entre les propos poursuivis qui seraient reproduits à plusieurs reprises de différentes manières, dès lors que cette dissonance aurait « pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits » dont le prévenu doit répondre4.
Dans une affaire contre le Canard Enchaîné, par exemple, la Cour de cassation a rappelé cette exigence de formalisme. Dans son édition du 22 octobre 2014, le journal avait fait paraître un article intitulé « La mairie de Lille n’a pas la fibre communicante », consacré aux opérations de démolition d’un immeuble susceptible de contenir de l’amiante.
Considérant que plusieurs passages étaient diffamatoires, le promoteur immobilier avait fait citer le directeur de la publication du journal devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique en poursuivant cinq propos dans les motifs de sa citation, mais en en oubliant un dans son dispositif (l’expression « omerta sur l’amiante »).
Par jugement du 5 avril 2016, la 17ème chambre du tribunal de Paris a prononcé la nullité des poursuites, compte tenu de la différence entre les propos poursuivis dans les motifs de la citation et ceux du dispositif.
Saisie sur appel de la partie civile, la cour d’appel de Paris a confirmé la nullité dès lors que les motifs de la citation « laisse[nt] clairement penser que cinq passages, dont l’un serait la conclusion des quatre autres, sont poursuivis alors que la citation ne reprend en son dispositif que quatre passages ; qu’ainsi le prévenu n’est pas en mesure de déterminer s’il doit se défendre ou non sur le 2ème passage qu’ « il existe une « omerta sur l’amiante » ; que c’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu qu’il résulte nécessairement de cette discordance une incertitude sur l’étendue exacte des propos poursuivis et qu’en conséquence, la citation introductive d’instance ainsi que les poursuites subséquentes devaient être annulées ».
Finalement, dans un arrêt tranché5, la Cour de cassation a, elle aussi, confirmé ce raisonnement pouvant paraître sévère, mais qui montre la préférence accordée à la liberté d’expression par rapport à la répression de ses éventuels abus.
En pratique, rares sont les erreurs de plume qui n’entraînent pas la nullité des poursuites :
- erreur dans l’indication du millésime de la date de la loi du 29 juillet 1881, alors que cette loi était par ailleurs indiquée sous la dénomination de loi sur la presse6 ;
- idem pour un réquisitoire introductif visant la loi du « 29 juillet 1991 »7 ;
- certaines erreurs de visa :
- le fait de viser l’article 32 alinéa 2 du code pénal au lieu de la loi du 29 juillet 1881, alors que l’intitulé du délit était par ailleurs mentionné sans équivoque8 ;
- le fait de viser de mauvais textes d’incrimination dès lors que « les erreurs relevées dans certains visas n’ont pas eu pour conséquence de créer une incertitude sur le contenu de la poursuite »9.
Les juridictions du fond, cependant, font parfois preuve d’une étonnante souplesse quand il existe une contradiction dans l’acte de poursuite entre les propos cités dans le rappel des faits et ceux cités dans la « discussion » juridique, faisant prévaloir la partie « discussion ».
Une telle faveur ne semble pourtant pas conforme à l’esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Parfois, il est vrai, malgré la sévérité globale de la jurisprudence, il semble que certaines juridictions du fond aient plus à cœur de s’attacher à des considérations morales ou factuelles que juridiques, pour sauver telle procédure d’une nullité qui paraissait pourtant inévitable au regard de certains précédents rendus par la Cour de cassation.
Ceci prouve qu’en matière de droit de la presse, malgré un formalisme exigeant et des erreurs souvent impardonnables, la place est encore faite, parfois, à la force de conviction. Tout se plaide !
Avocat associé
#Droit de la presse #Droit pénal des affaires # Diffamation # Injure
Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-83.150
Cass. crim., 5 janv. 2010, n° 09-84.328
Cass. crim. 17 juin 2008, n°07-87.920
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-80.325
Cass. crim., 27 fév. 2018, n°17-80.325
Cass. crim., 14 avr. 1992
Cass. crim., 28 sept. 1993
Cass. crim., 5 mars 2002, n°01-82.785
Cass. crim., 8 avr. 2014, n°13-81.048